SCEAUX (92) - MONOGRAPHIES
Marie AYCARD
"Sceaux et ses environs"
in : Ch. NODIER et Louis LURIN, Les Environs de Paris, Paris, P. Boizard & G. Kugelmann, Editeurs, [1844], pp. 111-130.
27 x 17,5 cm
Ham-Paris, collection Beaurain
***
Commentaire :
Cet ouvrage de 490 pages comprend une introduction, rédigée par Charles Nodier, suivie d'une série d'articles sur les environs de Paris dans son acceptation historique la plus large, que les directeurs de la publication confièrent à différents auteurs.
L'auteur de l'article consacré à Sceaux et ses environs, né Benoît Antoine Marie Joseph Aycard (1794-1859), n'était pas historien mais romancier, si bien que son récit, bien éloigné de la réalité des faits, contient des informations fantaisistes, voire même farfelues.
L'allégorie du Temps écrivant l'histoire des Environs de Paris (détail du frontispice)
***
L'ouvrage est "illustré de 200 dessins par les artistes les plus distingués", remis aux soins de plusieurs graveurs, parmi lesquels Ignacy Budzilowicz (1805-1863).
***
Cet exemplaire possède au verso de la première de couverture, en haut à gauche, le timbre de la librairie Clavreuil.
***
TABLE DES MATIERES
VERSAILLES, par LOUIS LURINE / BOIS DE BOULOGNE, par ALBERIC SECOND / VALLEE DE MONTMORENCY, par AMEDEE ACHARD / CHANTILLY, par CH. ROUGET / VINCENNES par ETIENNE ARAGO / SCEAUX ET SES ENVIRONS par MARIE AYCARD / MONTMARTRE ET SAINT-DENIS PAR LEROUX DE LINCY / SAINT-CLOUD ET SEVRES par TOUCHARD-LAFOSSE / COMPIEGNE par LE MARQUIS DE MONTEREAU / BELLEVILLE, LES PRES-SAINT-GERVAIS, ROMAINVILLE et MENILMONTANT par MAURICE ALHOY / LA MALMAISON par EMILE MARCO DE SAINT-HILAIRE / MONTLHERY par HIPPOLYTE LUCAS / MORTFONTAINE, ERMENONVILLE par LOUIS LURINE / DE CORBEIL A MELUN par MAURICE ALHOY / BRUNOY par LEON GOZLAN / LUZARCHES ET CHAMPLATREUX par ALPH. BROT. / SENLIS ET SES ENVIRONS par MARIE AYCARD / NEUILLY, MEUDON, BELLEVUE, ETC., par LOUIS LURINE / ANET ET DREUX par CH. DE PIERRY / LE PALAIS ET L'ABBAYE DE CHELLES, etc;, par ARSENE HOUSSAYE : RAMBOUILLET, par ETIENNE ARAGO / FONTAINEBELAU, par LOUIS LURINE / SAINT-GERMAIN, par JULES JANIN / BICETRE, par GUNEOT-LECOINTE / MARNES, VAUCRESSON, VILLE-D'AVRAY, par ADRIEN PAUL / MANTES, ROSNY, par JULES SANDEAU.
Le bal de Sceaux
" Lorsque Louis XIV, infidèle à Saint-Germain qui l'avait bu naître, mais d'où malheureusement on apercevait la flèche de Saint-Denis, eut doté Versailles de son palais doré et de ses eaux miraculeuses ; dès qu'il eut planté ces arbres aujourd'hui deux fois séculaires, tous les courtisans voulurent imiter un luxe qui flattait la vanité du maître ; tous demandèrent des plans à Mansard, des plafonds à Lebrun (sic), à Lenôtre (sic) des jardins. Colbert, le sage Colbert céda à l'entraînement général, et il ne s'attacha pas à un favori sans mérite comme avait fait Louis XIV : il tourna les yeux du côté du sud, prit le chemin qui mène à Orléans, dépassa Arcueil aux fraîches arcades, laissa derrière lui Bourg-la-Reine tout rempli encore des souvenirs d'Henri IV et de Gabrielle, et, à une demi-lieue de ce Fontenay où foisonnent les roses, il acheta, en 1670, la terre de Sceaux qui appartenait alors au duc de Tresme, lequel la tenait de Louis Potier de Gesvres, son frère, tué en 1621 au siège de Montauban. Le duc de Tresme avait eu le crédit de faire transporter à Sceaux des foires et des marchés de bestiaux, qui se tenaient auparavant à Bourg-la-Reine, et il est probable que ce fut une des raisons qui décidèrent l'habile ministre. Colbert employa toute son influence à favoriser les marchés de Sceaux, qui ont rsisté à toutes les révolutions, à tous les changements de gouvernement, de dynastie, et qui sont encore aujourd'hui des marchés rivaux à ceux de Poissy.
[pp. 112-113]
Le premier propriétaire, Potier de Gesvres, avait fait bâtir un château dont la tradition raconte encore des merveilles. Colbert ne voulait que des merveilles écloses sous le règne du grand roi ; il fit abattre le château. Tout fu abattu et remué ; il semblait que pareil au laboureur de La Fontaine, le ministre dut trouver un trésor sous chaque motte de terre : c'était tout simplement pour faire place nette aux architectes et à Lenôtre.
Le pavillon de l'Aurore
Le nouveau château s'éleva comme par enchantement. On y arrivait par une longue avenue qui partait du chemin d'Orléans pour ne finir que devant la grille de la cour d'honneur. Sept pavillons disposés en demi-lune, et communiquant à l'un à l'autre, par des galeries, formaient l'édifice entier. Colbert avait cédé au goût de son temps, et avait permis qu'on donnât aux divers pavillons, les noms : de Pavillons de Flore, de l'Eté, du Printemps, de l'Aurore. Il ne reste plus aujourd'hui que le pavillon de l'Aurore. C'est Girardon qui avait sculpté la Minerve qui brillait sur le fronton du pavillon principal ; la déesse était représentée assise et, par un artifice du sculpteur, de quelque côté qu'on la regardât, on la voyait tout entière. Ainsi Colbert laissait au roi Bellone, Vénus, Mars et Jupiter lui-même ; il permettait aux courtisans de se partager tous les dieux, tous les demi-dieux de l'Olympe, il ne se réservait que Minerve. La chapelle, l'orangerie répondaient à la magnificence du château, et les jardins, moins vastes que ceux de Versailles et de Chantilly, ne le cédaient en élégance, dit un historien de l'époque, qu'à ceux que planta Lenôtre à Clagny quelques années plus tard. Le jardinier courtisan réservait les prodiges les plus exquis de son art pour la maîtresse du roi ; aussi ce qu'en dit madame de Sévigné :
'Nous fûmes à Clagny ; que vous dirai-je ? C'est le palais d'Armide. Le bâtiment s'élève à vue d'œil ; les jardins sont faits...! Vous connaissez la manière de Lenôtre. Il a laissé un petit bois sombre qui fait fort bien. Il y a un bois entier d'orangers, dans de grandes caisses ; on s'y promène, ce sont des allées où l'on est à l'ombre ; et, pour cacher les caisses, il y a des deux côtés des palissades à hauteur d'appui, toutes fleuries de tubéreuses, de roses, de jasmins et d'œillets. C'est assurément la plus belle, la plus surprenante et la plus enchantée nouveauté qui se puisse imaginer... On aime fort ce bois."
Les petits bois obscurs pouvaient convenir à madame de Montespan : ce n'était pas l'affaire de Colbert : aussi Lenôtre entoura-t-il le château de Sceaux d'arbres de haute futaie. Sur l'un des côtés du parterre était l'orangerie ; de l'autre s'élevait un massif de marronniers qui formaient un vaste carré ; on l'appelait le salon des marronniers. Le milieu était occupait par un bassin auquel deux figures représentant Carybde et Scylla fournissaient de l'eau. L'élément liquide s'échappait par torrents de la bouche des deux monstres placés l'un vis-à-vis de l'autre ; il tombait en écumant dans le bassin, dont la surface n'était jamais tranquille. On raconte que Colbert allait quelquefois dans le salon des Marronniers et qu'il jetait des morceaux de pain dans le bassin. Si le pain atteignait le bord opposé sans être englouti par Carybde ou par Scylla ni dévoré par les carpes, alors le ministre quittait Sceaux satisfait de son épreuve ; dans le cas contraire, il n'abordait le lendemain Louis XIV qu'en tremblant. Faiblesse commune aux grands hommes et qu'ils ont pratiquée ailleurs qu'à Sceaux. Quoique Louis XIV ait visité Sceaux et qu'il y ait entraîné plusieurs fois toute sa cour, les jours les plus brillants de cette résidence princière ne datent que de la régence.
[pp. 114-115]
Après la mort de Colbert, Sceaux devint la propriété du duc du Maine, qui l'acquit en 1700. Ce prince, l'élève chéri de madame de Maintenon, n'avait aucune des qualités nécessaires au rôle qu'il voulait jouer ; et, d'ailleurs, suivant l'expression de Philippe d'Orléans ; il fallait du courage, de la résolution et même de l'éloquence pour y parvenir ; toutes ces qualités lui manquaient, et la régence lui échappa. La duchesse du Maine, le surprenant un jour durant ces débats, occupé dans son cabinet à traduire l'Anti-Lucrèce, lui dit :
-Monsieur, un beau matin, vous trouverez en vous éveillant que vous êtes de l'Académie et que M. d'Orléans est à la Régence.
Le duc ne sut conserver ni le commandement des troupes de la maison du Roi, ni la surveillance de la personne du jeune monarque, qui lui étaient attribués par le testament de Louis XIV : il se laissa même dépouiller de tous les privilèges attachés à la qualité de prince légitime, et il ne fut pas de l'Académie. Alors il ne parut plus à la cour et se retira à Sceaux qui devint un centre de conspirations contre l'administration du Régent, et même, assure-t-on, conte sa vie. Le duc du Maine n'était pour rien dans toutes ces menées, auxquelles on aurait pu donner le nom de factions, si elles avaient été conduites avec plus de sérieux et plus d'habileté, et que sa femme, la duchesse, a empreintes d'un caractère de puérilité. Cette princesse était fille de Henri-Jules de Bourbon, fils du grand Condé, personnage qui a passé les vingt dernières années de sa vie dans une démence qui le rendait quelquefois furieux et toujours ridicule ; c'est lui qui, au cercle du Roi, se cachait dans l'embrasure d'une fenêtre pour satisfaire le plus mystérieusement possible le besoin qu'il éprouvait d'aboyer. La duchesse du Maine, sans avoir l'esprit aliéné comme son père, était cependant sujette à des accès de déraison qu'on appelait des moments de vapeur : elle battait alors ses gens, sa femme de chambre et jusqu'à son mari ; du reste, femme d'esprit, qui aimait les lettres, et recherchaient avec passion ceux qui les cultivaient. Hardie jusqu'à la témérité et aussi faible qu'un enfant, elle avait la taille d'une fille de dix ans et n'était pas bien faite ; mais de beaux yeux, un teint blanc et des chevaux blonds embellissaient sa figure ; si on ajoute à cela une grande activité, un rang élevé, une immense fortune et l'art d'attirer à soi les mécontents, on comprendra qu'elle ait pu se former un parti dans un moment de régence. Son principal confident fut le cardinal de Polignac, qui passait pour son amant ; son complice, M. de Cellamare, ambassadeur d'Espagne à Paris ; il ne s'agissait de rien moins que de faire disparaître le duc d'Orléans et de mettre la régence et le royaume dans les mains du roi d'Espagne. Ce complot fut tramé à Sceaux, dans le château qu'avait bâti Colbert, sous les arbres qu'il avait plantés. On sait comment il fut découvert par les soins de Dubois et l'intermédiaire de la Fillon, personne que les mauvaises mœurs de Dubois lui faisaient fréquenter, et dont nous nous abstiendrons ici de dire le métier. Le duc du Maine fut arrêté à Sceaux même. S'il n'était l'instigateur du complot, s'il en avait laissé à sa femme la conduite et l'exécution, il y avait, sans aucun doute, donné les mains ; cependant, une fois arrêté et conduit à la forteresse de Doullens, où il fut plutôt détenu que prisonnier, il montra la plus grande pusillanimité et rejeta tout sur sa femme et sur ses complices. -Ce n'est pas en prison, écrivait-il à sa sœur la duchesse d'Orléans, qu'on devait me mettre, c'est en jaquette, pour m'être laissé mené par le nez ainsi que je l'ai fait.
La duchesse du Maine, arrêtée à Paris, eut aussi peu de courage le jour de l'épreuve qu'elle avait eu de hardiesse avant le danger. Les deux époux avouèrent tout : et, par leurs aveux, ils compromirent leurs serviteurs et leurs amis : Polignac, Laval, Malezieu, Magny, de Mesmes. Les uns furent mis à la Bastille, les autres exilés ; une seule personne montra dans cette affaire autant d'esprit que de courage, autant d'adresse que de générosité, ce fut mademoiselle de Launay, une femme de chambre ! Il est vrai que mademoiselle de Launay, depuis madame de Staal, n'était pas une femme de chambre ordinaire. Sceaux ne fut pas longtemps désert ; ses cascades ne tarirent pas ; l'absence de ses hôtes fut trop courte pour que les statues de son parc eussent le temps de se couvrir d'une mousse verdâtre. Quoique le crime fût capital, on ne voulait pas sévir contre un fils de Louis XIV et une fille des Condé; et, si l'on épargnait les plus coupables, il fallait faire grâce aux autres. Le Régent, d'ailleurs, n'était ni vindicatif, ni sanguinaire ; il se contenta d'exiler la duchesse du Maine à Dijon, puis à Châlons-sur-Saône, et, après avoir exigé d'elle un aveu humiliant, il lui permit d'habiter de nouveau l'asile verdoyant de Sceaux et de reprendre, non pas le cours de ses intrigues, mais celui de ses fêtes, qu'embellissaient la présence et le talent des hommes les plus remarquables d'alors. C'est là que Voltaire est venu réciter ses premières tragédies, Chaulieu ses derniers vers ; Fontenelle, quoiqu'ami du Régent et employé par Dubois dans les bureaux du ministère, y a lu son Histoire des Oracles ; Lamothe récité ses Odes, plus tard si amèrement critiquées par Voltaire ; enfin, c'est à un souper à Sceaux que M. de Saint-Aulaire fit, pour la duchesse du Maine, ces vers qui composent à peu près tout son bagage littéraire et qui l'ont fait recevoir à l'Académie : la duchesse venait de le comparer à Apollon et lui demandait je ne sais quel secret, M. de Saint-Aulaire répondit :
La divinité qui s'amuse
A me demander mon secret,
Si j'étais Apollon, ne serait point ma muse ;
Elle serait Thétis et le jour finirait.
[pp. 116-117]
La disgrâce du duc du Maine dura plus longtemps ; on lui permit cependant d'habiter sa terre Chavigny, près de Versailles, et peu de temps après, il put aller rejoindre la duchesse à Sceaux. La Régence était trop occupée avec la banque de Law pour ne pas mettre en oubli deux conspirateurs aussi peu dangereux que le duc et la duchesse du Maine. Toute l'activité que madame du Maine avait déployée à intriguer et à conspirer, elle l'employa à trouver de nouveaux plaisirs, à inventer de nouvelles fêtes, Colbert n'avait pas fait de Sceaux un séjour assez magnifique, la duchesse l'embellit encore ; elle orna les jardins d'un des chefs-d'œuvre du Puget, l'Hercule gaulois ; elle y fit placer une copie en bronze du Gladiateur et deux statues antiques, une Diane et un Silène élevant Bacchus, morceaux qui, plus tard, ont orné le Musée National. Madame du Maine fit enfin construire, sur le pavillon principal du château, une espèce de lanterne vitrée qu'elle appelait sa chartreuse, retraite aérienne où elle se retirait pour se livrer seule à toute l'amertume de ses projets déçus : là, l'horizon s'étendait pour elle, et ses tristes regards pouvaient voir Paris et ce Palais-Royal qui lui était fermé. Peu à peu cependant, sa douleur se calma, son agitation s'éteignit, et Sceaux redevint ce qu'il avait été avant la conspiration de Cellamare, et, pour employer le style du temps, il fut de nouveau le séjour des jeux et des ris. Nous avons parlé de M. de Malezieu qui, compromis par la duchesse, passa quelque temps à la Bastille ; c'était un bel esprit savant, un mathématicien poète, qui avait été précepteur du duc du Maine et faisait des vers pour la duchesse. On a de lui les Amours de Ragonde, opéra qui a joui dans son temps d'une longue vogue, et plusieurs ouvrages scientifiques dont nous ne parlerons pas. M. de Malezieu était le poète de Sceaux, l'ordonnateur de toutes les fêtes ; il faisait de petits opéras qu'il jouait et chantait lui-même, de petites satires dialoguées, où l'on n'osait pas persifler le gouvernement du Régent., mais où l'on tombait sans pitié sur l'Académie, qui n'avait point de Bastille pour se venger de ses détracteurs : témoin Polichinelle demandant une place à l'Académie, petit vaudeville mordant et incisif dont M. de Malezieu amusa d'abord les seigneurs de Sceaux et qu'il livra ensuite aux rires des Parisiens, en le faisant représenter par les marionnettes de Brioché. Madame du Maine était la principale actrice de son théâtre ; elle s'était réservé l'emploi des grandes coquettes et celui des soubrettes ; tour à tour Célimène ou Dorine, Cidalise ou Laurette, c'était surtout sous ce dernier nom que les Chaulieu, les Lafare, les Saint-Aulaire, la célébraient dans leurs vers ; ils comparaient Laurette à la Laure de Pétrarque et il est inutile de dire à laquelle des deux ils donnaient la préférence. Les nuits de Sceaux étaient alors des nuits enflammées ; on illuminait le parc, les jardins, on plaçait des lampions autour des bassins, dans les anfractuosités de toutes les cascades ; cela s'appelait marier Vulcain et ses Cyclopes avec les naïades et les hamadryades. Un sieur de Villeras, ancien officier d'artillerie, pétrissait le salpêtre et le soufre et improvisait des feux d'artifice rivaux de ceux de Versailles et d ela Place-Royale. Malezieu, qui s'était dévoué toute la vie aux plaisirs et aux intérêts de la famille du Maine, fut magnifiquement récompensé par elle ; madame du Maine n'oublia pas son poète, elle l'enrichit, elle le fit seigneur de Châtenay (dont nous parlerons ci-après), lui donna une belle maison et partagea ses loisirs entre les plaisirs de Sceaux et ceux que la spirituelle galanterie de Malezieu lui préparait à Châtenay.
La dévotion outrée dans laquelle tomba le duc du Maine suspendit d'abord ces plaisirs et finit par les interrompre tout à fait ; l'âge, d'ailleurs, avait aussi glacé la verve de Malezieu et dégoûté du théâtre la duchesse elle-même. On rapporte que l'abbé Genest lui apportant une tragédie qu'il voulait faire représenter sur le théâtre de Sceaux :
L'abbé Genest apportant une tragédie à la duchesse du Maine
-Allez aux comédiens du roi, lui dit-elle, Sceaux en est aux litanies... Apportez-nous des sermons.
[pp. 118-119]
Après la mort du duc du Maine, Sceaux devint la propriété de son fils, le prince d'Eu, le prince aux longues lèvres, comme l'appelait la mère du Régent. Celui-ci vendit ces lieux enchantés au fils du comte de Toulouse, le duc de Penthièvre. Ce prince, dont la bonté était plus réelle et plus vraie que celle d'Henri IV lui-même, n'avait pas les autres qualités du Béarnais : il n'était ni guerrier ni vert galant. Grand-amiral de France, il ne put jamais s'accoutumer à la vie aventureuse et pénible des marins ; grand-veneur, il n'aima pas la chasse. Marié à Marie-Thérèse Félicité d'Este, fille du duc de Modène, il vécut avec elle dans l'union la plus intime et ne se consola jamais de l'avoir perdue. D'un tempérament qui le portait à l'esprit ascétique, sa dévotion égalait celle du duc du Maine, sans avoir cependant l'égoïsme et la dureté qui faisaient le fonds des croyances acerbes du fils de madame de Montespan. Le duc de Penthièvre n'aimait pas le séjour de Sceaux, et il y a passé sa vie retenu par le bien qu'il y faisait et par l'empressement du public à visiter ses jardins. Comme le duc du Maine, il eut un Malezieu, un poète aimable, serviteur dévoué et ami fidèle : nous avons nommé Florian, parent de Voltaire, page du duc, et bientôt, par le crédit de son protecteur, capitaine de cavalerie dans le régiment de Royal-Penthièvre. Florian, né d'une mère espagnole, eut toute sa vie un attrait particulier pour la langue que parlait sa mère et pour une littérature plus riche qu'on ne le croyait généralement alors. Il traduisit et imita les pastorales de Cervantes, et, quoiqu'on lui ait spirituellement reproché de n'avoir pas mis de loups dans ses bergeries, elles eurent un grand succès ; il traduisit Don Quichotte avec plus d'élégance que de fidélité, et s'il resta fort au-dessous d'un original inimitable, sa traduction se lit néanmoins encore aujourd'hui avec plaisir. Il y avait à Sceaux un théâtre qui avait retenti des accents de la duchesse du Maine et des vers adulateurs de M. de Malezieu ; Florian, distributeur secret des aumônes du duc de Penthièvre, eut le bon goût de ne pas imiter son devancier et de ne pas louer la bienfaisance du prince dans son palais même. Malezieu avait égayé les soirées de la duchesse du Maine avec les facéties de Polichinelle ; Florian rajeunit, pour plaire au duc de Penthièvre, le personnage d'Arlequin. Tout en laissant au Bergamais ses balourdises et sa bonhommie, il lui donna de la grâce et de la sensibilité ; et semblable encore à M. de Malézieu, il joua lui-même ses pièces avec talent. En 1783, Louis XVI vint à Sceaux ; ce domaine princier lui plut, il témoigna le désir de l'acheter. Le duc de Penthièvre vendit Sceaux au Roi pour la somme de dix-huit millions et se retira à Vernon ; ce fut là le premier malheur de Florian, qui vint alors habiter Paris. Cependant la Révolution éclata et tandis que les princes de la maison de Bourbon quittaient la France, le duc de Penthièvre, protégé par une popularité depuis longtemps acquise, vécut tranquille et vénéré dans l'asile qu'il s'était choisi. Il mourut à Vernon, en 1793, trente-cinq jours avant le décret de la Convention qui condamnait les Bourbons à l'exil et mettait leurs biens sous le séquestre. La mort de M. de Penthièvre fut aussi douce que sa vie. Florian a été moins heureux ; emprisonné en 1793 et transféré à la Bourbe, qu'on appelait alors Port-Libre, il composa dans sa prison Guillaume Tell, le plus faible de ses ouvrages ; et, enfin rendu à la liberté, il courut, pour rétablir sa santé compromise, sous les ombrages où il avait vécu si content et si libre ; mais à peine âgé de trente-huit ans. Ses Fables l'ont placé au rang des littérateurs qui laissent après eux un souvenir durable ; elles occupent une place distinguée après celles de La Fontaine. Une pierre tumulaire marque à peine sa place dans le cimetière de Sceaux ; on y lit cette simple épitaphe qu'y a fait graver Mercier :
ICI
REPOSE LE CORPS
DE FLORIAN
HOMME DE LETTRES
Dans le même champ de repos est enterré Cailhava, auteur de quelques comédies remarquables par une gaieté dont la tradition se perd tous les jours au théâtre ; il mourut à Sceaux en 1813.
C'est en vain qu'on chercherait aujourd'hui à Sceaux les merveilles de l'art, les miracles dus au génie de Lenôtre et au pinceau de Lebrun. Le château bâti par Colbert et, à grands frais, embelli par deux princes du sang, a été démoli durant la tourmente révolutionnaire. Les naïades ont quitté leurs cascades taries ; le parc lui-même, le parc de sept-cent arpents, a subi les outrages de la hache et les blessures de la cognée. Une bibliothèque précieuse et riche en livres rares et en éditions remarquables a été dispersée et livrée à l'avidité des spéculateurs. Néanmoins, lorsqu'en 1798, le domaine de Sceaux fut vendu comme bien national, il se trouva un homme qui, plus jaloux de l'intérêt de la commune que de son intérêt particulier, acheta les jardins du château et le lieu qu'on appelait la ménagerie ; M. Desgranges, maire de Sceaux, fit cette acquisition avec l'aide de quelques amis, et il abandonna au public un terrain planté de beaux arbres et sur lequel croissait une pelouse verdoyante. A l'entrée de ce lieu, on lisait les vers suivants :
De l'amour du pays ce jardin est le gage ;
Quelques-uns l'ont acquis, tous en auront l'usage
Telle fut l'origine des bals de Sceaux qui, pendant quarante ans, ont eu une vogue qui dure encore. Quoique les bals se soient multipliés à l'infini dans les environs de Paris, quoiqu'on danse partout, Sceaux l'emporte toujours sur les localités rivales, et il semble que l'esprit gracieux de madame du Maine y voltige toujours dans les bosquets, et y rende plus doux et plus complet le plaisir de la musique et celui des danses champêtres.
[pp. 120-121]
Non loin de Sceaux, se trouve Berny, lieu charmant où étaient rassemblées les fleurs les plus rares, les eaux les plus pures et les plus jaillissantes, les plus grasses prairies, prés de moines, c'est tout dire. Berny était jadis la maison de plaisance des abbés de Saint-Germain-des-Prés ; c'était là que venaient s'ébattre les religieux de l'abbaye, quand septembre dorait les fruits et jaunissait en même temps et le pampre et la grappe de la vigne ; et si, comme les maisons princières, Berny ne brillait pas par les statues éparses dans ses jardins, on y trouvait un autre luxe approprié au goût des jeunes abbés ; à l'extrémité de toutes les allées, étaient des jeux de boules, des escarpolettes, des jeux de bagues, des arènes préparées pour la lutte, le saut, la course et tous ces exercices gymnastiques qui séduisirent jadis la dame des Belles-Cousines, et la rendirent infidèle au féal Jehan de Saintré. En 1696, cependant, ces délassements monastiques éprouvèrent une fâcheuse interruption : il s'agissait d'amuser le grand Roi qui, au dire même de madame de Maintenon, était devenu inamusable. Les courtisans mettaient leur esprit à la torture pour dissiper la torpeur maladive qui s'était emparée de Louis, et les plus habiles inventèrent l'ambassade de Siam. On fit la leçon à un vieux forban retiré, lequel s'entoura de huit ou dix drôles échappés de Fez ou de Maroc, et on annonça l'ambassadeur de Siam qui venait, de la part de son maître, baiser les pieds du grand sultan français et lui offrir l'aloès, la myrrhe et l'encens. Louis XIV fut la dupe de cette comédie, qui l'amusa quelques jours ; il traita royalement le prétendu ambassadeur, lequel, en attendant le jour de sa présentation, fut logé avec sa suite à Berny. Ces hôtes nouveaux, sectateurs fanatiques de Mahomet et pleins d'horreur pour tout ce qu'avait touché la main impure des giaours, dédaignèrent la cuisine des abbés de Saint-Germain-des-Prés, ne voulurent pas même du bois empilé sous les hangars, et, détruisant les escarpolettes, mettant en pièces les eux de bagues, ils firent rôtir leurs moutons et bouillir leur pilaus de safran au pied des hêtres : les allées de Berny furent saccagées par les infidèles, ses charmilles dévastées, ses fleurs foulées aux pieds, et, à trois lieues de Paris, le croissant insulta la croix ; mais Louis XIV étala les diamants de la couronne devant une douzaine de maghrébins ; et, le soir, assis dans son grand fauteuil, vis-à-vis de madame de Maintenon, il eut quelque chose à lui dire.
Le village de Châtenay
Si vous voulez voir un joli village, ombragé de beaux châtaigniers qui lui ont donné leur nom, sortez de Berny pour aller à Châtenay, qu'on appelait autrefois Châtenay-les-Bagneux, à cause de Bagneux qui est tout près. C'est encore un fief clérical ; les Templiers y avaient une seigneurie. Bâti sur un côteau qui reçoit les premiers rayons du soleil, Châtenay étale aux regards le luxe de ses maisons de campagne et de ses ombrages verdoyants. Si la Ferté-Milon a vu naître Racine, Château-Thierry La Fontaine ; si le petit village de Crosne se vante d'avoir donné le jour au satirique Boileau, Châtenay peut s'enorgueillir d'une illustration aussi glorieuse : un homme qui a rempli de son nom tout le XVIIIe siècle. Voltaire y est né le 20 février 1694. Le village de Bagneux a inspiré beaucoup de fables aux historiens des environs de Paris : on a prétendu qu'il existait déjà aux temps de la domination romaine ; le père Daniel nous parle de Bagneux, à propos du VIe siècle, et la tradition nous assure que Bagneux nous a légué des médailles qui portent l'effigie du roi Caribert. L'église de Bagneux est très-remarquable ; elle date du XIIIe siècle et reproduit dans de petites proportions, le vaisseau de Notre-Dame de Paris. Aunay-les-Châtenay n'est pas loin, et plus bas se trouve la Vallée-aux-Loups, vallon étroit et entouré d'ombrages délicieux. C'est dans cette vallée qu'a longtemps vécu, livré aux charmes de l'étude, le poète qui a entrepris d'opposer la poésie du christianisme à celle d'Homère et de Virgile, d'entourer la Vierge des saintes amours de plus de grâces et de séductions que n'en eurent jamais les créations du génie antique. Après avoir achevé son voyage en Palestine, M. de Chateaubriand fit bâtir, dans la Vallée-aux-Loups, un château gothique avec tourelles, mâchicoulis, fossés et pont-levis. Déjà en Angleterre, lord Walpole avait exécuté un projet semblable ; mais l'ami de madame du Deffant était aussi sceptique que vain, et il entrait dans son œuvre autant d'orgueil aristocratique que de moquerie. L'auteur du Génie du christianisme obéissait au contraire à une conviction profonde : amoureux de la gloire militaire des siècles chevaleresques, il s'entourait par goût, par religion de famille, de souvenirs féodaux, et, comme il convenait à un gentilhomme breton, il cherchait à reproduire dans sa demeure les images guerrières qui, trois cents ans auparavant, avaient dû frapper les regards des Clisson et des du Guesclin. Un parc entoure le château et reproduit, assure-t-on, quelques sites de la Palestine, dont M. de Chateaubriand était jaloux de garder plus fidèlement le souvenir. C'est dans ce château qu'ont été composé les Martyrs, et que, sous des ogives sarrasines, sont apparues à l'auteur les ombres de Démodocus, d'Eudore, de Cymodocée, d'Hiéroclés et de Velleda. Ce château singulier et si bien approprié au génie du maître, M. de Chateaubriand fut obligé de le vendre. Il lui avait coûté des sommes immenses ; il comprit que peu d'acheteurs pourraient s'accommoder de ses fantaisies poétiques ; il le mit en loterie et proposa chaque billet pour mille francs : quatre-vingt-dix-mille francs le château du poète ! Une page des Martyrs avait été payée plus cher qu'un billet. Trois seulement furent pris ! La propriété fut vendue cinquante-et-un mille francs, valeur foncière du terrain ; le château fut compté pour rien ! Ce château, plein de souvenirs si littéraires, est aujourd'hui la propriété de M. Sosthène de La Rochefoucault. C'est aussi de la Vallée-aux-Loups que sont datées les plus gracieuses poésies de M. H. de Latouche, qui l'a longtemps habitée.
[pp. 122-123]
Tous les lieux qui entourent Sceaux sont enchantés et portent des traces du luxe de nos aïeux, qui se sont plu à les habiter. A Laï, ou Lha[ÿ], on voit une tour remarquable pour sa solidité et par un escalier qui, placé en dehors, mettait ainsi les habitants des environs dans la confidence des rapports journaliers des propriétaires ; elle date du Xe siècle. On raconte que, cinq-cents ans plus tard, une des nobles châtelaines de Laï, dont le mari était parti pour des guerres lointaines, étant fatiguée de l'affectation qu'on mettait à compter les visites d'un jeune page, fit élever dans la tour même un escalier intérieur pour parer à cet inconvénient. Le châtelain de retour fit détruire l'escalier, et depuis ce temps la tour n'a plus été habitée ; il était difficile, en effet, de rétablir l'escalier sans éveiller les soupçons, et fâcheux d'habiter une tour où l'éducation des pages était impossible.
Vue fantaisiste de la propriété de Chateaubriand à la Vallée-aux-Loups
Antony n'a pas une date aussi ancienne que Laï ; il a cependant subi le double joug de la noblesse et du clergé et gémi sous la même oppression qui pesa longtemps sur Berny et sur Châtenay ; la Ligue y a secoué son flambeau et les guerres de religion en ont plusieurs fois décimé les habitants. On y admire encore, dans l'église paroissiale, le chœur qui a été bâti au XIVe siècle. On appelait alors ce village Antoigny ; depuis longtemps une certaine douceur de mœurs et de langage ont converti ce nom en celui plus euphonique d'Antony. Plus loin est Verrières, célèbre par ses bois et ceux de Malabry qui l'avoisinent ; bois chéris des Parisiens, qui en parlent beaucoup moins qu'ils ne parlent de ceux de Montmorency et de Romainville, mais qui y vont davantage. C'est là que l'amour discret aime à se cacher ; c'est là qu'il s'égare sous le dôme verdoyant de mille allées sinueuses. Ces beaux bois ont eu leurs jours de désolation et de gloire. En 1815, ils furent occupés par les Prussiens ; le brave général Excelmans attaqua ces ennemis ; suivi seulement du 5e et du 15e de dragons, il les défit, les dispersa , les poursuivit jusqu'à Versailles, où ils tentèrent vainement de lui résister : fait d'armes glorieux, mais hélas ! inutile, et qui ne nous empêcha pas de subir le joug des puissances alliées. Vingt ans auparavant, les bois de Verrières servirent d'asile au malheureux Condorcet et ne surent pas le sauver. Il fuyait, déguisé en maçon, le visage blanchi d'un plâtre récent, les mains chargées d'une truelle et d'un marteau qu'il ne savait pas manier ; affamé comme un homme qui a passé la nuit à errer d'un lieu à un autre, il entra le matin dans une petite auberge établie sur la lisière du bois et demanda à manger. -Que veux-tu manger, citoyen ?
-Une omelette
Et la Léonarde du lieu tenait sa poêle d'une main, et de l'autre atteignait à un panier où étaient rassemblés tous les œufs de la basse-cour.
-Combien d'œufs ? demanda-t-elle.
Condorcet accablé de fatigue, l'esprit plein de terreur, et d'ailleurs distrait comme un philosophe, répondit :
-Une omelette de douze œufs.
[pp. 124-125]
Or, un homme seul ne fait pas faire une omelette de douze œufs, et les individus rassemblés dans ce méchant cabaret, pensèrent qu'un plat pareil dépassait, sinon l'appétit, du moins les moyens d'un maçon de village. On entoura Condorcet, on l'interrogea, on exigea ses papiers et il fut bientôt regardé comme suspect. On le conduisit alors à Clamart, et de Clamart à Bourg-la-Reine, où il dût passer la nuit pour être conduit le lendemain à Paris. Dans la nuit, il s'empoisonna ; et ceux-là mêmes qui l'avaient arrêté lui rendirent les derniers devoirs et ignorèrent quelle victime ils avaient faite. Ainsi périt, à deux pas de la maison de Gabrielle, un homme qui avait contribué à l'abolition de la monarchie. Bourg-la-Reine s'appelait alors Bourg-Libre. Les historiens les plus exacts , les antiquaires les plus érudits ont tous ignoré quelle reine lui avait fait donner ce nom : on en est réduit, pour trouver une étymologie raisonnable, à recourir à un conte de fées ou de chevalerie, ce qui revient à peu près au même. Il y avait donc une fois une princesse plus belle que le jour, dont deux fils de rois devinrent amoureux ; la belle princesse était coquette, chose assez simple chez une jolie femme, qu'elle porte ou non une couronne ; elle déclara qu'elle épouserait le plus vaillant ou le plus heureux ; et les princes d'assembler deux grandes armées et de convier leurs peuples à s'entr'égorger, afin que l'un d'eux eut pour femme une blonde aux yeux bleus. C'était l'usage alors, et les peuples dociles se formèrent en bataillons et s'assemblèrent, prêts à en venir aux mains, dans une vaste prairie appelée le Pré-Vert, premier nom qu'ait porté Bourg-la-Reine. Le combat allait commencer, lorsque les Nestors des deux camps s'abouchèrent ; et, peu jaloux sans doute de se faire tuer, eux et leurs enfants, pour une nouvelle Hélène, ils furent d'avis que les deux princes devaient vider leur querelle dans un combat singulier ; des manans (sic), des vilains étaient-ils dignes d'avoir l'honneur de se battre pour une belle princesse ? Il ne fallait d'ailleurs qu'un maladroit, dans chacun des deux camps, pour tuer les deux princes, et alors personne ne profiterait du fruit de la victoire. L'avis était sage, il fut suivi. Les deux princes se battirent courageusement ; l'un fut tué, l'autre perdit un œil et l'usage d'un bras, mais il épousa la princesse ; et le bourg qui, avant ce mémorable événement, s'appelait Pré-Vert ou Briquet, s'appela Bourg-la-Reine. L'archevêque Turpin n'a pas seul recueilli cette chronique ; de plus graves personnages que l'aumônier de Charlemagne s'en sont emparés ; on la trouve dans presque tous les historiens qui ont parlé de Bourg-la-Reine.
L'Arrestation de Condorcet à Clamart
Vers le milieu du
bourg, à gauche, en venant de Paris, s’ouvre une longue et étroite avenue qui
conduit à la maison de cette maîtresse d’Henri IV, dont une chanson a rendu le
nom si populaire ; elle est bâtie en briques rouges, elle est grande,
spacieuse, et, quoique l’art de l’architecte ait suivi les progrès du siècle et
qu’on sache aujourd’hui tirer meilleur parti de l’espace et du terrain, on
reconnaît aisément, en parcourant la maison de Gabrielle, qu’un roi pouvait
l’habiter sans déroger et ne pas s’y trouver trop à l’étroit, même après avoir
quitté le Louvre. La chambre de Gabrielle est toujours intacte ; mais,
quand nous l’avons visitée, elle était livrée aux ébats d’une douzaine
d’enfants qui jouaient à cache-cache dans les parois de l’immense cheminée.
Cette maison princière était louée à un instituteur.
Nous ne dirons rien
de Bièvre, célèbre seulement par ses manufactures de toiles peintes et par une
rivière dont les eaux teintes de mille couleurs ne se dépouillent que
difficilement de l’indigo et du vermillon qu’y dépose l’industrie. Non loin de
là, est le village de Cachant (sic), où le jeune Camille Desmoulins a
passé de si douces heures auprès de sa femme qu’il adorait ; heureux si
cette obscure retraite avait pu le dérober à la prison du Luxembourg et au fer
de la guillotine !
Fontenay,
qu’embellissent les roses, est encore une dépendance de Sceaux. Là, la fleur si
chérie des orientaux avec les soins qui jadis, à Paestum, lui faisait deux fois
l’an couronner les jardins de Clynéas. Ce village odorant, qui date du Xie
siècle, tire son nom des sources qui l’arrosent et le fertilisent. Autrefois
Fontenay, qu’on appelait Fontenay-les-Bagneux, avait le privilège exclusif de
fournir de roses la reine de France, les princesses et la cour tout
entière : aujourd’hui les parquets de nos palais ne sont plus, comme
autrefois jonchés de verdure et de fleurs, et les meilleures pratiques des
cultivateurs de Fontenay sont les pharmaciens. La rose est apportée à Paris
dans de vastes corbeilles, et au lieu d’être foulée par les pieds des reines,
au lieu d’être tressée en couronnes pour orner le front des jeunes princesses,
elle est mise au mortier et broyée par le pilon. Si les roses ne doivent vivre
qu’un jour, qu’importe leur destin ! Mourir dans une officine ou se
flétrir dans un palais, c’est tout un, puisqu’i faut aller où vont toutes
choses, puisque la rose d’une saison tombe comme le château séculaire.
Fontenay se fait gloire
d’avoir donné le jour à Scarron et à Chaulieu. On lui dispute le premier,
Morin, ce compilateur si souvent inexact, mais dont on adopte quelquefois les
erreurs, faute de contrôle, prétend que Scarron naquit à Paris, en 1610, dans une
petite maison du Marais ; le fait n’est pas certain. Ce qui est hors de
doute, c’est que le père de l’auteur du Roman comique, conseiller au
parlement et homme riche, avait une maison de campagne à Fontenay, où s’écoula
l’enfance de son fils, parmi les sentiers parsemés de roses, présage menteur de
la vie qui l’attendait. Mais Scarron était doué d’une gaieté qui devait
résister à l’abandon, à la pauvreté et à la maladie. Son premier malheur fut la
mort de sa mère : le conseiller au parlement se remaria, et Scarron
comprit parfaitement que, là où se trouve une marâtre, le fils d’un premier lit
doit renoncer aux biens paternels ; il prit le petit collet et le titre
d’abbé qui, n’entraînant alors aucune obligation, donnaient, dans le monde, aux
rejetons de la magistrature et de la noblesse, un passe-port indulgent pour les
fredaines de jeunesse. Il fit ses premières armes sur la Place Royale,
c’est-à-dire dans la société de Marion de Lorme, de Ninon de Lenclos, de la
comtesse de la Suze et de mademoiselle de Lude ; il était le compagnon de
plaisir de jeunes seigneurs débauchés de son temps ; il partageait sa vie
entre les ruelles et la villa de son père, à Fontenay. Jusqu’à vingt-sept ans,
il ne s’occupa que de galanteries, d’études littéraires et, s’il faut tout
dire, de débauches ; alors les drogues de quelques charlatans, ou une
aventure de carnaval, l’arrêtèrent tout à coup. Une lymphe corrosive attaqua
ses nerfs ; la sciatique, le rhumatisme, escortés de souffrances aiguës,
vinrent l’enchaîner sur son fauteuil de cul-de-jatte et le rendirent, comme il
l’a écrit lui-même, un raccourci des misères humaines. Ni le séjour de Fontenay, ni deux ou trois voyages aux eaux de Bourbon ne purent le guérir, et alors il demanda à la reine d'être son malade en titre d'office ; Anne d'Autriche, que les troubles de la Fronde n'occupaient pas encore, accepta, et le malheureux ne signa plus que : -Scarron, par la grâce de Dieu, malade indigne de la reine. En relisant le portrait qu'il a tracé de lui-même, on voit que jamais charge ne fut mieux remplie.
"Lecteur, dit-il, qui ne m'a jamais vu, et qui, peut-être, ne t'en soucies guères (sic), à cause qu'il n'y a pas beaucoup à profiter de la vue d'un homme tel que moi, sache que je me soucierais aussi peu que tu me visses, si je n'avais pas appris que quelques beaux esprits facétieux se réjouissent à mes dépens et me dépeignent d'une autre façon que je ne suis fait. Les uns disent que je suis cul-de-jatte ; les autres que je n'ai pas de cuisses et que l'on me met sur une table, dans un étui, où je cause comme une pie borgne ; et les autres que mon chapeau tient à une corde qui passe dans une poulie, et que je le hausse et baisse pour saluer ceux qui me visitent. Je pense être obligé, en conscience, de les empêcher de mentir plus longtemps. J'ai trente ans passés, et, si je vais jusqu'à quarante, j'ajouterai bien des maux à ceux que j'ai déjà soufferts depuis huit à neuf ans. J'ai eu la taille petite, quoique bien faite, ma maladie l'a raccourcie d'un bon pied ; ma tête est un peu grosse pour ma taille ; j'ai le visage assez plein pour avoir le corps très-décharné ; des cheveux assez pour ne pas porter perruque, j'en ai beaucoup de blancs............................................................................................................................................................
Mes jambes et mes cuisses ont fait premièrement un angle obtus, et puis un angle égal, et puis enfin un angle aigu. Mes cuisses et mon corps en font un autre, et ma tête, se penchant sur mon estomac, je ne ressemble pas mal à un Z. J'ai les bras raccourcis aussi bien que les jambes. Enfin, je suis un raccourci de la misère humaine."
Mazarin donna au malade de la reine cinq cents écus de pension ; mais la Fronde arriva, Scarron ne pouvait être que de l'opposition, il fit la Mazarinade : le ministre supprima la pension. On dit que si Mazarin, au lieu d'être Italien, avait été Français, il l'aurait doublée. e fut alors que la nécessité de vivre et le besoin de se distraire de ses souffrances par le travail amènerait Scarron à écrire pour le théâtre. On a joué pendant plus de cent ans dom Japhet d'Arménie, Jodelet, Maître et Valet et autres farces dont la grossièreté fait voir en quel état le théâtre était réduit avant les chefs-d'œuvre de Molière. Cependant le théâtre lui doit l'invention d'un personnage que des auteurs ont exploité après lui avec succès : c'est dans une de ses pièces, l'Ecolier de Salamanque, qu'a paru le premier Crispin. Scarron a d'autres titres à la gloire littéraire ; il a laissé des nouvelles et un roman écrits avec le style naturel et libre qui distinguent les œuvres de Rabelais et de Montaigne. Aussi les meilleures esprits du temps, le cardinal de Retz, Ménage, Villarceaux, se réunissaient-ils dans son petit salon jaune pour écouter la lecture de ses ouvrages. Il demandait à ses protecteurs un bénéfice, mais si simple, si simple, qu'il ne fallût que croire en Dieu pour le desservir ; il ne l'obtint pas, mais le hasard lui ménageait une compensation. Ninon lui fit faire la connaissance de mademoiselle d'Aubigné, orpheline qui vivait des dures charités d'une tante avare ; Scarron lui proposa de l'épouser, et quelque difforme qu'il fût, il parut à la jeune fille moins laid que le couvent. Quand on dressa le contrat, le notaire demande la chiffre de la dot que le futur reconnaissait à sa fiancée :
"Ecrivez, dit Scarron, quatre louis d'or, deux grands yeux très mutins, un très-beau corsage, une belle paire de mains et beaucoup d'esprit."
Vingt ans plus tard, Louis XIV épousa la veuve du cul-de-jatte ; mais le douaire de madame de Maintenon fut plus considérable.
Scarron mourut à Paris, en 1660, d'un accès de hoquet contre lequel il n'eut pas le temps de faire une satire ainsi qu'il en avait le projet. Il expira en regrettant les ombrages de Fontenay, sous lesquels il avait passé les seuls années de sa vie qui aient été sans douleurs.
En 1639, naquit à Fontenay Chaulieu qui, comme Scarron, prit le petit collet au sortir de l'enfance et fut un des hommes les plus heureux de son temps. Tandis que son compatriote et son contemporain ne pouvait pas obtenir le plus léger bénéfice, Chaulieu, protégé par la puissante famille de Vendôme, fut nommé abbé d'Aumale et posséda, en outre, les prieurés de Saint-Georges en l'île d'Oléron, de Poitiers, de Chenel, de Saint-Etienne et autres lieux. Comme la résidence lui eût été difficile, il se fixa au Temple, voluptueux séjour du grand-prieur de Vendôme, et là, riche et oisif, il faisait ces vers faciles qui lui ont assigné, dit Voltaire, la première place parmi les poètes négligés. Il a vécu sans soins, s'abandonnant à ses goûts épicuriens et se laissant aller à tous les caprices de son caractère qui, de son aveu, était impatient, colère, glorieux, actif et paresseux en même temps. Recherché des personnages les plus considérables de son temps, libertin décent et buveur toujours raisonnable, il atteignit les bornes de la plus extrême vieillesse sous ce règne brillant qui vit naître les chefs-d'œuvre de Corneille, de Molière et de Racine. Quand les grands hommes eurent disparu, Chaulieu, toujours brillant et heureux, partagea encore les joies de la régence. Nous avons parlé de mademoiselle de Launay, cette spirituelle femme de chambre de la duchesse du Maine ; mademoiselle de Launay fut son amie et adoucit, pour cet Anacréon octogénaire, les douleurs de la seule maladie dont il ait été atteint : la goutte.
"Il me fit connaître, dit mademoiselle de Launay dans ses mémoires, qu'il n'y a rien de plus heureux que d'être aimé de quelqu'un qui ne prétend rien de vous."
Ainsi, jusque dans cette dernière liaison, Chaulieu eut le bonheur et le bon goût d'éviter le ridicule et les déboires qui suivent les vieillards amoureux.
Dans cette longue vie, Fontenay ne fut jamais oublié ; Chaulieu s'y retirait avec délices, et la meilleure de ses odes, celle que préfère La Harpe, est l'ode sur la Solitude de Fontenay. Il mourut en 1780 (sic) et, selon son vœu, il a été enterré à Fontenay près des arbres qui l'ont vu naître.
J'ai nommé deux fois dans cet article mademoiselle de Launay ; je vais la nommer une troisième fois, si vous voulez bien me le permettre. Mademoiselle de Launy était une petite fille assez laide, quand on la voyait dans une première rencontre, et presque charmante, quand on avait le plaisir de la revoir. -Mademoiselle de Launay était un dragon de vertu, mais un dragon qui se défendait avec toute la douceur d'une honnête femme à l'épreuve. -Mademoiselle de Launay, qui était si bien faite pour commander aux autres, passa ses meilleures années à obéir à tout le monde ; elle aurait eu le droit de répondre à ses supérieurs, en faisant une variante à un mot spirituel de Figaro : "aux qualités qu'il me faut avoir pour vous servir, connaissez-vous beaucoup de maîtres qui soient dignes d'être mes serviteurs ?" Madame la duchesse du Maine, par exemple, aurait été bien embarrassée de lui répondre. -Mademoiselle de Launay nous a légué des mémoires charmants tout remplis de délicatesse, de sentiment et d'intérêt ; c'est un livre que tout le monde devrait connaître et adorer. -Mademoiselle de Launay, qui avait résisté aux prières galantes de bien des gens d'esprit, se laissa prendre à la galanterie d'un homme peu spirituel : elle épousa M. de Staal.
[p. 130]
Allez donc à Fontenay dans le mois des roses, lorsque mai fait épanouir toutes les fleurs, vous y trouverez l'ombre de Chaulieu et peut-être l'ombre de mademoiselle de Launay ; allez à Fontenay, et, si vous avez cinquante mille livres de rentes, achetez une des jolies maisons qui le décorent, vous vivrez heureux au milieu des plus attrayants souvenirs et dans le lieu le plus favorisé entre mille, tous gracieux, tous enchantés, qui environnent Paris."
Chemin dans un sous-bois
***
Commentaire :
Il semble nécessaire de rétablir certains faits :
Au début de son récit, l'auteur écrit que Colbert détruisit le château de ses prédécesseurs : il l'enveloppa d'une nouvelle construction afin d'obtenir une plus vaste demeure. Il mentionne également deux bassins qu'il situe dans les parterres de l'Orangerie. Ces bassins se situaient dans les bosquets sud ; ils contenaient les figures d'Eole et de Scylla. Il n'est nulle part fait mention d'un bassin de Charybde.
L'auteur attribue le décor sculpté du jardin de Sceaux à la duchesse du Maine. Cette affirmation doit être rejetée : la presque totalité des statues ont été acquises par Colbert et son fils Seignelay : c'est notamment le cas de l'Hercule Gaulois de Pierre Puget, et bien sûr de toutes les copies d'antique. Par ailleurs, la Chartreuse de la duchesse du Maine, décrite comme une "lanterne vitrée" était en fait un appartement aménagé pour la princesse au deuxième étage du château.
La princesse fut très proche de Nicolas de Malezieu, grand ordonnateur des divertissements de Sceaux, mais c'est le duc du Maine qui lui offrit la seigneurie de Châtenay. L'abbé de Chaulieu, qui fréquenta la cour de Sceaux, mourut en 1720 et non en 1780, comme indiqué dans l'article.
L'auteur affirme que le comte d'Eu, fils cadet du duc et de la duchesse du Maine, mort sans descendance, vendit Sceaux au duc de Penthièvre : c'est faux. A sa mort, en 1775, la demeure revint, selon ses dernières volontés, à Louis XVI, qui le rétrocéda au duc de Penthièvre. Là encore, Marie Aycard confond Sceaux et Rambouillet, que Louis XVI désira posséder et racheta à ce prince.
Ce n'est enfin pas le maire de Sceaux, M. Desgranges, qui racheta le domaine de Sceaux, mais Hippolyte Lecomte. Celui-ci revendit en 1799 le jardin de la Ménagerie à la Société des Eaux et des Jardins de Sceaux, dont le maire était partie prenante. Cette Société eut l'idée, pour entretenir les lieux, d'y organiser des festivités et, notamment, le fameux bal de Sceaux.
L'auteur parle également d'une fausse ambassade du Siam, composée d'un "vieux forban" et de "huit ou dix drôles échappés de Fez et de Maroc", que les courtisans auraient imaginée pour divertir Louis XIV. Les ambassadeurs du Siam ont cependant bien existé, séjourné à Berny et même visité les jardins de Sceaux. Il n'y eut aucune supercherie et ce passage est levfruit de l'imagination débordante du romancier.
Dans la suite de son récit, Marie Aycard évoque Chateaubriand, qui fit l'acquisition du domaine de la Vallée-aux-Loups, dans le hameau d'Aulnay, à Châtenay. Il prétend alors que l'homme de lettres s'y fit construire un château gothique. Il vécut en fait dans la maison d'André-Arnoult Acloque, construite à la fin du XVIIIe siècle, qu'il fit agrandir, décorer et réaménager à son goût. Il créa cependant le parc de quatorze hectares de la propriété.
***
SCEAUX ILE-DE-FRANCE MONO04



















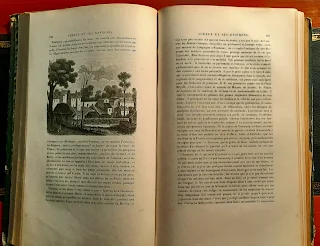







Commentaires
Enregistrer un commentaire
LAISSEZ VOS COMMENAIRES, REMARQUES ET QUESTIONS